Le projet de recherche MathéMOTiques (ancien LEXIMATH) porté par Anne Lafay (LPNC, USMB) a été sélectionné pour obtenir un financement du pôle Pégase. Laura Alaria (LNPC, USMB), Carole Berger (LPNC, USMB), et Sonia Angonin (conseillère pédagogique, IEN Albertville) sont les autres membres du projet.
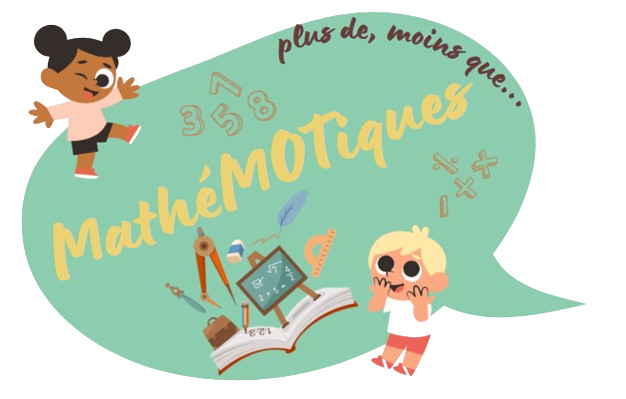
Les capacités mathématiques prédisent le succès à l’école (Duncan et al., 2007) et sont associées au statut socioéconomique (Ritchie & Bates, 2013), à la qualité de vie de l’enfant et de son entourage (Matteucci et al., 2019) et à l’anxiété mathématique chez l’enfant et l’adulte (Maloney & Beilock, 2012).
Il existe un lien entre le développement du langage général chez l’enfant et le développement de ses compétences mathématiques (LeFevre et al., 2010 ; Peng et al., 2020). Plus récemment, des chercheurs ont investigué la relation entre un lexique mathématique et le développement des compétences mathématiques. Plus encore que les compétences lexicales générales, le lexique mathématique permettrait l’accès à la
« compréhension des mots-clés et des concepts utilisés dans les premières compétences à acquérir en mathématiques » (Purpura et al., 2019, p. 178, traduction libre). Il est effectivement relié aux compétences mathématiques de base (calcul), mais aussi aux compétences mathématiques de haut niveau (fractions, algèbre, résolution de problème à énoncé verbal). Le lexique mathématique représenterait ainsi un medium qui faciliterait l’apprentissage du raisonnement mathématique (Lin et al., in press).
La question de l’acquisition du lexique mathématique intéresse particulièrement les enseignants du cycle 1 dont la mission pédagogique relève à la fois du domaine langagier et des mathématiques. Une investigation autour de l’acquisition de ce concept semble d’ailleurs particulièrement pertinente pour les enfants en situation de multilinguisme et ceux issus d’un milieu défavorisé. Effectivement, l’écart obtenu entre les scores en mathématiques des élèves en France et ceux des autres pays de l’OCDE est plus important pour les élèves socialement défavorisés (évaluation Timss 2019). Ces derniers sont sur-représentés parmi les enfants présentant les moins bons résultats et sous-représentés parmi ceux qui ont les meilleurs résultats en mathématiques (Cnesco, 2021). Aucune étude, à notre connaissance, n’a investigué le lexique mathématique des enfants en situation de multilinguisme et/ou issus de milieu défavorisé, spécifiquement sur le territoire français. D’ailleurs, ces deux facteurs sont souvent confondus dans les études alors qu’il semblerait plus pertinent de les considérer de manière indépendante. Effectivement, s’il est montré que les enfants en situation de multilinguisme et les enfants issus d’un milieu défavorisé présentent un retard de langage général dans la langue d’instruction (Barac & Bialystok, 2012), les causes et l’expression de ce retard lexical peuvent être très différentes, notamment concernant le lexique mathématique. De plus, l’exploration du développement en contexte multilingue a souvent mené à l’observation d’un avantage exécutif pour cette population, or les compétences en mathématiques sont fortement reliées aux fonctions exécutives, particulièrement en début d’apprentissage (Emslander & Scherer, 2022). Les compétences langagières étant également liées aux fonctions exécutives (Schmitt et al., 2019), l’exploration simultanée de toutes ces compétences en maternelle devient cruciale pour mieux déceler et agir sur les déterminants des habiletés mathématiques des élèves, quel que soit leur arrière-plan linguistique et social.
Comprendre les déterminants du développement des compétences mathématiques et favoriser ce développement sont sans nul doute d’intérêt public. Ce projet s’inscrit dans une perspective de collaboration entre chercheuses et enseignant.e.s avec un objectif de réduction de la pente du gradient social des compétences en mathématiques, en promouvant des actions universelles pour tous les élèves, mais avec une ampleur et une intensité proportionnelle au niveau de défaveur sociale, selon le principe d’universalisme proportionné (Marmot, 2010).


